Suggestion d'articles



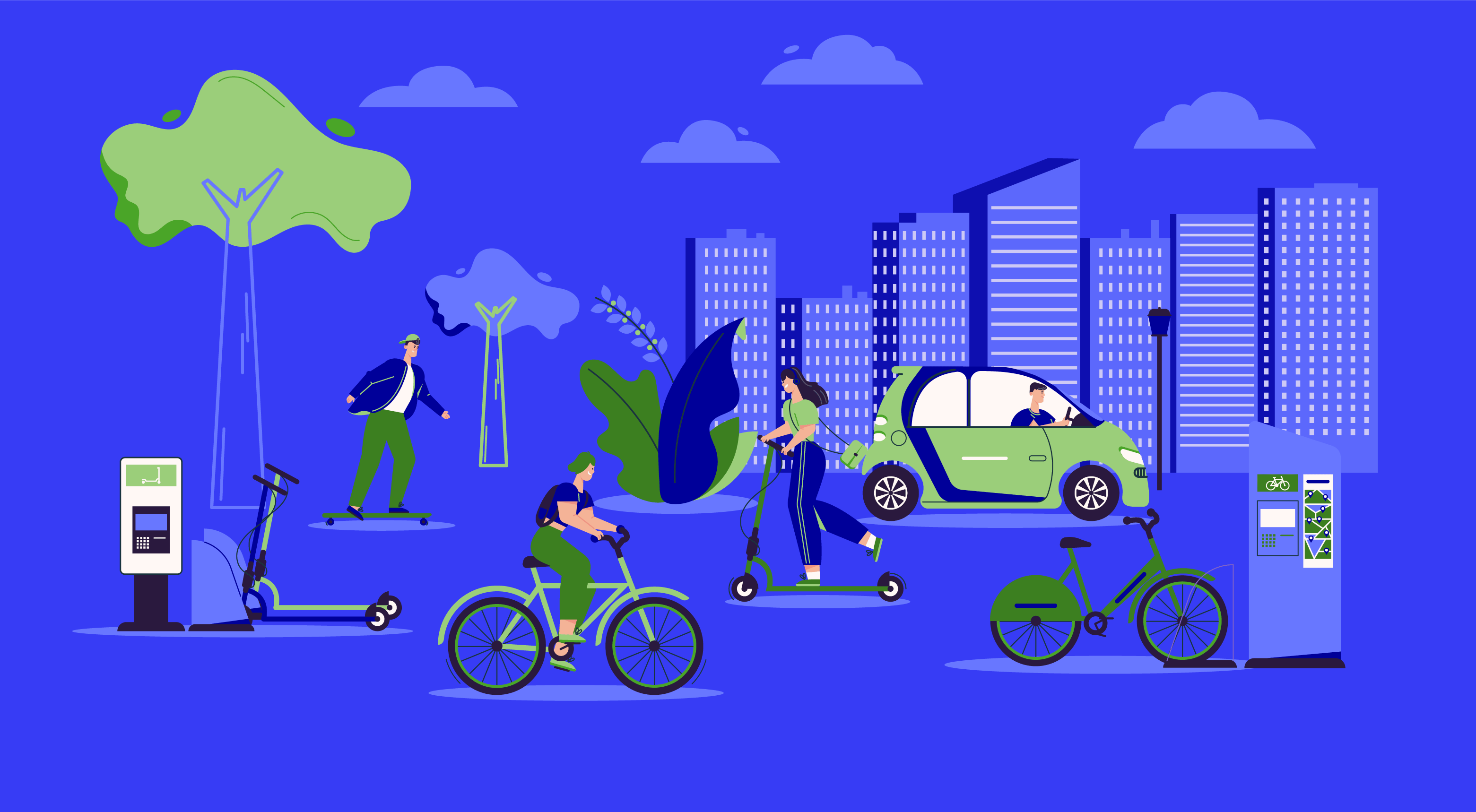

Décryptage : la raison d'être
Depuis sa promulgation, la loi Pacte permet aux entreprises d'inscrire une raison d'être dans leurs statuts. Que recouvre cette expression et quels changements induit-elle pour les entreprises ? Décryptage.
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, introduit, dans le droit français, la notion de raison d’être de l’entreprise. À l’origine de cette expression, il a le rapport Notat-Sénard sur le thème L’entreprise, objet d’intérêt collectif, remis au Gouvernement, le 9 mars 2018. Ses auteurs, Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, et Jean-Dominique Sénard, alors président du groupe Michelin, précisent que « des attentes croissantes à l’égard des entreprises sont régulièrement exprimées, avec l’essor des défis environnementaux et sociaux » et que « chaque entreprise a donc une raison d’être non réductible au profit ».
Une option et une ligne de conduite pour l'entreprise
Concrètement, la loi Pacte complète l’article 1835 du Code civil, consacré à la définition des statuts de l’entreprise, avec la phrase suivante : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » Définir une raison d'être est donc facultatif pour l'entreprise, mais, le cas échéant, ses principes doivent être validés par son conseil d'administration et ses actionnaires.
Dans leur guide Loi Pacte & raison d’être, et si on passait à la pratique , l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et le Collège des directeurs développement durable (C3D) s’accordent sur la définition suivante : « la raison d’être est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise qui sera, pour elle, à la fois une boussole et un garde-fou quant aux décisions du conseil d’administration et du directoire. » Selon Fabrice Bonnifet, le président du C3D, interrogé par Novethic, il s’agit en fait de formaliser « ce que l’entreprise apporte à l’humanité ».
Un engagement vis-à-vis de l'entreprise et ses parties-prenantes
Sur la forme, l’entreprise est libre de rédiger sa raison d’être, dans ses statuts, avec plus ou moins de précisions. Il va sans dire que, plus elle sera détaillée, plus elle sera contraignante. Plus elle sera vaste, plus elle sera difficile à interpréter et à respecter. Chaque société qui souhaite formaliser sa raison d’être a donc intérêt à le faire en l’intégrant pleinement à sa stratégie et en impliquant au maximum l’ensemble de ses membres et parties prenantes.
Le guide ORSE et C3D conseille de rédiger une raison d'être :
- pertinente : elle doit être corrélée à l'activité et aux enjeux de l'entreprise ;
- ambitieuse : elle doit apporter une utilité sociétale, « à tout point de vue » ;
- structurante : elle doit donner un cap à l'entreprise et apporter des engagements concrets ;
- impactante : dans toutes les étapes de l'activité et la vie de l'entreprise.

Quelques exemples d'entreprises et de leur raison d'être
- Danone : « apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre » ;
- Michelin : « Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer » ;
- Le Crédit Agricole : « Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société » ;
- Nutriset : « Apporter des propositions efficaces aux problématiques de nutrition/malnutrition des enfants ».
Pour en savoir plus :