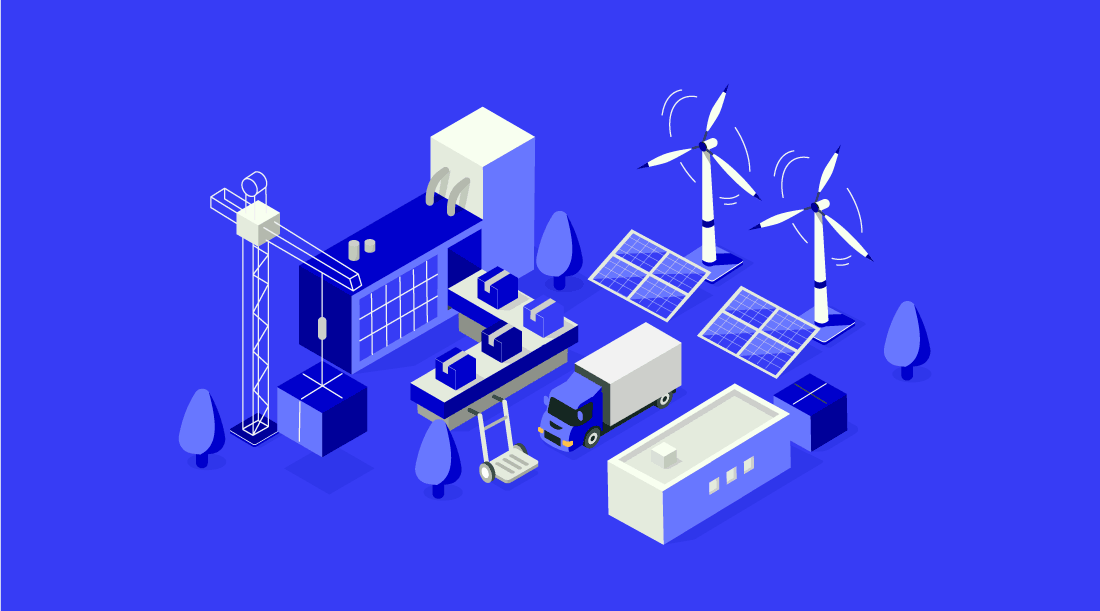L'eau, le cadre juridique général
En France, les ressources en eau font l’objet d’une gestion intégrée par bassin hydrographique. Les bassins hydrographiques sont délimités par les lignes de partage des eaux superficielles.
12 bassins ont été délimités :
- 7 bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie
- et 5 bassins d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte.
Au niveau européen, la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, fixe un objectif à atteindre pour l’ensemble des Etats-Membres de l’Union européenne : le bon état des eaux. Pour les eaux de surface, le bon état des eaux de surface est le bon état écologique et chimique. Pour les eaux souterraines, le bon état correspond au bon état chimique et quantitatif.
La stratégie des bassins français pour atteindre le bon état des eaux en 2021, objectif de résultat fixé par la directive cadre sur l’eau de 2000, se décline dans les plans de gestion des eaux par grands bassins hydrographiques, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Ces SDAGE sont préparés et validés par les acteurs de l’eau, dans le cadre des grandes orientations des politiques nationale et européenne de l’eau, au sein des Comités de bassin où s’exercent le débat et la concertation locale. Les Comités de Bassin sont composés de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des usagers.
La mission des agences de l’eau et des offices de l’eau ultra-marins s’inscrit dans la stratégie des SDAGE qui définissent, pour chaque bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource et les objectifs de quantité et de qualité des eaux. Les objectifs des SDAGE constituent un engagement français vis-à-vis des autorités européennes.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015, après un vaste processus d’élaboration et de concertation (y compris avec le grand public) animé par les comités de bassin. Les grands thèmes abordés par les SDAGE sont les suivants : objectifs de qualité ; de quantité ; eau potable et santé publique ; protection des milieux aquatiques ; lutte contre les inondations ; gestion concertée.
Les SDAGE 2016-2021 sont complétés par des programmes de mesures (plans d’actions). La portée des SDAGE est importante. Les documents d’urbanismes (schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales…) doivent être en effet compatibles avec leurs orientations fondamentales et leurs objectifs, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas comporter de dispositions contraires au SDAGE. Il en va de même des décisions administratives dans le domaine de l’eau et celles concernant les installations classées pour la protection de l’environnement.
Au niveau local, les SDAGE sont déclinés en SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux). Ceux-ci-sont élaborés par les Commissions locales de l’eau. Il existe 191 SAGE ou projets de SAGE :
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs de gestion durable de l'eau, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Sur l’aspect quantitatif de l’eau, le règlement peut :
- « Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage » (article L. 212-5-1 du code de l’environnement).
Sur l’aspect qualitatif de l’eau, le règlement peut :
- « Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau » (article L. 212-5-1 du code de l’environnement).
Retrouvez toute la réglementation sur l’eau et plus généralement sur l’environnement