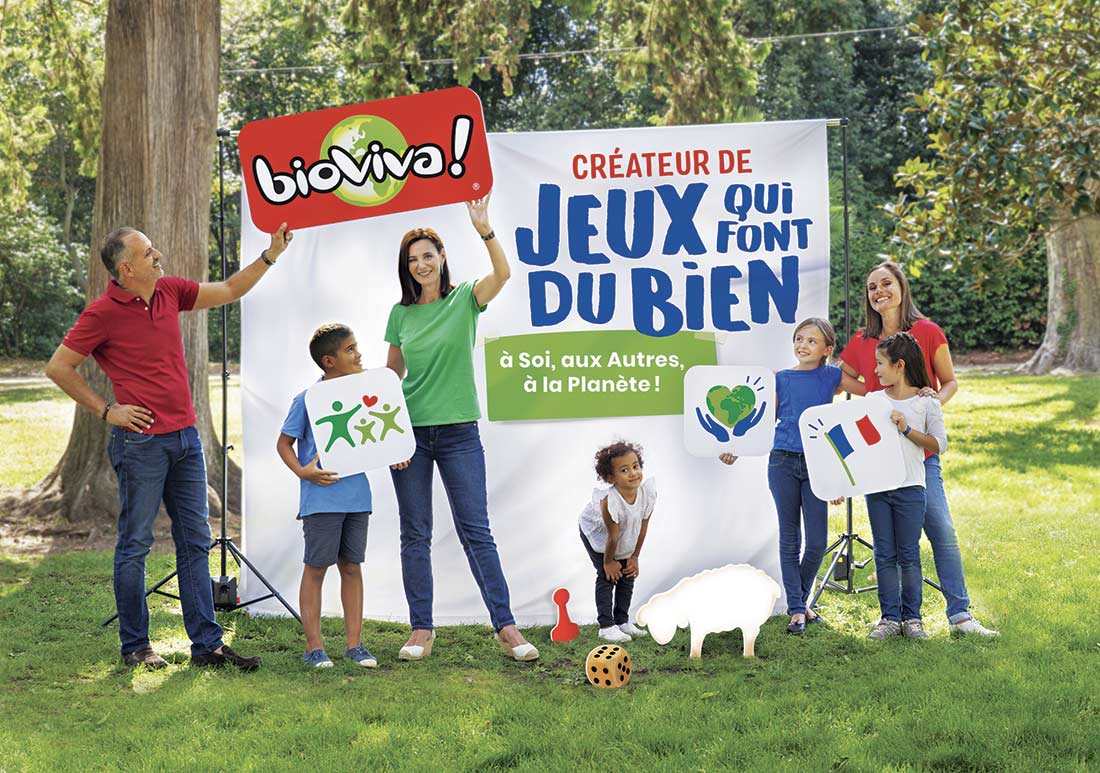Comment réussir son parcours de décarbonation ?
Un parcours de décarbonation, c'est la photo à un instant T des émissions carbone de l'entreprise, l'objectif qu'elle se fixe et le plan d'action pour l'atteindre. Présentation du parcours à suivre en 5 étapes !
Étape 1
Réaliser un état des lieux
Avoir une vision claire des principaux postes de consommations énergétiques et des émissions de GES est une première étape essentielle d’un parcours de décarbonation. Cet état des lieux se déroule en deux temps :
Mener un audit énergétique
Depuis 2015, les entreprises de plus de 250 salariés doivent réaliser un audit énergétique. Toutefois, toutes les entreprises ont un intérêt à le réaliser car il constitue le socle indispensable à une bonne maîtrise de l’énergie. En effet, un audit énergétique permet de :
- Connaître les consommations énergétiques par poste et par usage
- Estimer des économies potentielles (énergétiques et financières)
- Identifier des leviers d’action pour améliorer la performance énergétique.
Un audit, c’est 10 à 25 % de gains potentiels de la facture énergétique annuelle !
Découvrez le parcours énergie du réseau CCI
Quantifier ses émissions de GES
Les sources d’émissions de GES sont classées en trois périmètres appelés scopes :
- Scope 1 : les émissions directes générées par les combustibles fossiles utilisés par l’entreprise (chaudière gaz/fioul, véhicules thermiques, …).
- Scope 2 : les émissions indirectes générées par la production d’énergie achetée et consommée par l’entreprise (électricité, vapeur, chaleur, froid).
- Scope 3 : les autres émissions indirectes émises dans la chaîne de valeur amont et aval (approvisionnements en matières premières, déplacements domicile-travail et professionnels, utilisation des produits vendus, déchets produits, etc.).
Les entreprises de plus de 500 salariés (250 pour les départements d’outre-mer) ont l’obligation de réaliser et de publier un bilan GES (scopes 1, 2 et 3) tous les 3 à 4 ans selon leur taille. Toutefois, toutes les entreprises ont un intérêt à mesurer leurs émissions de GES pour définir une trajectoire efficace de décarbonation autour des postes d’émission les plus importants.
La méthode la plus utilisée en France est le Bilan Carbone®, selon une méthodologie développée par l’ADEME. Le réseau CCI déploie un outil d’évaluation carbone simplifiée à destination des PME/PMI : le diagnostic LISE® conçu par les CCI qui permet d’obtenir une estimation rapide de leur empreinte carbone sur les scopes 1 et 2.
Etape 2
Elaborer un plan d’action
L’état des lieux des consommations énergétiques et des principaux postes d’émissions de GES va permettre d’élaborer un plan d’action autour des principaux leviers de décarbonation identifiés, en lien avec la stratégie de développement de l’entreprise.
L’entreprise peut agir à plusieurs niveaux, en commençant par les actions sur lesquelles elle a plus de contrôle et d’influence pour réduire ses émissions de GES (scopes 1 et 2), et avec des solutions rapides à mettre en œuvre.
Les actions de décarbonation nécessitant des investissements à moyen terme pourront faire l’objet d’études (de faisabilité et de dimensionnement) qui permettront de les hiérarchiser selon une grille multicritères (potentiel de décarbonation, coûts, disponibilité des ressources, maturité de la technologie, etc.)
La mobilisation des salariés de l’entreprise sera une des clés de réussite, notamment par la mise en place d’actions de sensibilisation aux enjeux climatiques et aux écogestes et la constitution d’une équipe de personnes référentes.
Dernier prérequis avant de passer à l’action : l’élaboration d’un plan de financement pour estimer les coûts de la démarche globale (acquisition de nouveaux équipements, formation des employés, mise en place de nouveaux processus, …) et repérer les aides disponibles.
Les conditions d’accès aux aides sont décrites dans la plateforme Mission Transition écologique
Étape 3
Réduire ses consommations énergétiques
Plusieurs solutions existent pour permettre aux entreprises de réduire leurs consommations énergétiques.
Mettre en place une démarche de sobriété énergétique et matières
La sobriété énergétique et matières permet d’économiser des ressources dans le processus de production d’un bien ou d’un service, grâce notamment à :
- La réduction des fuites et des gaspillages ;
- L’éco-conception des produits ;
- L’utilisation de matières premières issues du recyclage ;
- La mise en place d’écogestes.
Adopter des éco-gestes, une façon simple et efficace de réduire les émissions de CO2 et les coûts opérationnels
Des éco-gestes simples et efficaces peuvent être mis en place au quotidien tels que :
- Eteindre les lumières et les appareils non utilisés (ordinateurs, imprimantes, etc.)
- Minimiser les envois de mails superflus
- Economiser le papier (imprimer recto-verso, réutiliser les feuilles déjà imprimées comme brouillon, …)
- Optimiser la température des locaux (chauffage et climatisation)
- Eviter d’utiliser des gobelets à usage unique
- Réduire les déplacements professionnels en avion
- Favoriser les mobilités douces et encourager le covoiturage.
Améliorer l’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique permet d’économiser de l’énergie tout en maintenant le service rendu. Le potentiel d’économies d’énergie est évalué à 20 % par le déploiement des meilleures techniques disponibles telles que :
- L’utilisation d'équipements à haute performance énergétique ;
- L’éclairage basse consommation (ampoules LED) ;
- L’automatisation des systèmes consommateurs d’énergie (ex : capteurs intelligents, thermostats programmables) ;
- L’isolation des bâtiments (toitures, parois, …).
Etape 4
Avoir recours aux énergies décarbonées
Le recours à des énergies décarbonées en substitution des énergies fossiles est un puissant levier de décarbonation. Plusieurs solutions sont complémentaires :
- Le choix d’un fournisseur d’énergie verte, et si possible, une offre soutenant les énergies renouvelables locales.
- L’électrification des procédés, avec une préférence pour une électricité décarbonée issue des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique) ou du nucléaire.
- La production d’énergie à partir de sources renouvelables ou de récupération sur le site ou à proximité.
Quelques exemples :- L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et/ou en ombrière sur les parkings ¹.
- L’installation de bornes de recharge pour une flotte de véhicules électriques.
- La récupération de la chaleur fatale (l'énergie thermique émise par un procédé pouvant être utilisée pour un autre usage), par exemple, en utilisant la chaleur produite par les data centers pour chauffer des locaux.
- La production de chaleur avec une chaudière aux granulés de bois ou avec des pompes à chaleur qui puisent des calories dans l’environnement extérieur ou via un réseau de chaleur alimenté en énergies renouvelables et de récupération.
- La substitution du gaz fossile par des gaz renouvelables (le biométhane et demain l’hydrogène décarboné). Le biométhane peut être soit produit directement sur place en valorisant les déchets organiques de l’entreprise, soit produit à proximité (dans une unité de méthanisation par exemple) et acheminé par les réseaux gaziers existants.
La compensation des émissions carbone, un complément à la décarbonation.
Elle consiste à séquestrer une partie des émissions de CO2, en utilisant des puits de carbone naturels (ex : la plantation d’arbres) ou des puits technologiques (ex : le captage-stockage du CO2 en profondeur dans des formations géologiques).
Étape 5
Suivre et évaluer les actions mises en place
La décarbonation est un processus d’amélioration continue.
Il est utile de suivre régulièrement l’efficacité des actions mises en œuvre afin de mesurer les progrès réalisés (économies d’énergie et financières, baisse des émissions de GES, …) et d’ajuster si besoin le plan d’action en conséquence, d’autant plus que les circonstances et les réglementations peuvent évoluer.
Les progrès et les défis rencontrés pendant la phase de mise en œuvre pourront être valorisés auprès des équipes en interne et communiqués en externe pour rendre compte de l’engagement de l’entreprise et de ses actions concrètes en faveur de la décarbonation. Communiquer ses données de performance environnementale aux parties prenantes présente de nombreux avantages : amélioration de la réputation, satisfaction client, marque employeur.
Il est possible de faire auditer la démarche de l’entreprise par un organisme agréé indépendant et d’obtenir une certification (selon la norme ISO 50001 pour certifier le Système de Management de l’Énergie, la norme ISO 26000 pour certifier la démarche de Responsabilité sociétale …).
¹ La loi APER du 10 mars 2023 impose aux propriétaires de certains bâtiments de + de 500 m2, notamment à usage tertiaire, ou de parkings de + de 1500 m2 d’installer une surface minimum de panneaux photovoltaïques.