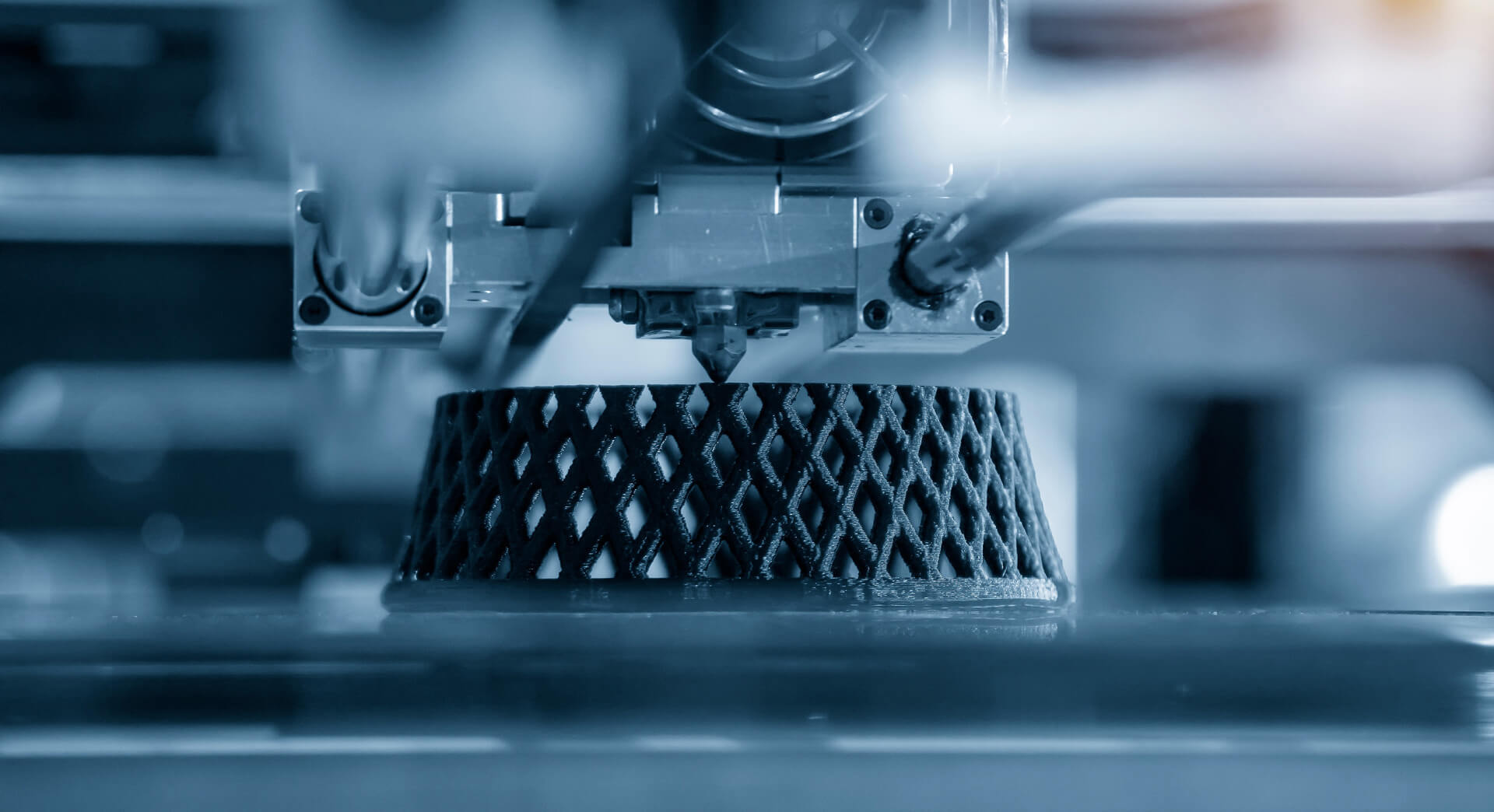L’hydrogène dans les régions françaises, une dynamique répartie
L’hydrogène est un vecteur essentiel de la transition énergétique pour plusieurs raisons :
- sa capacité à être stocké permet d’envisager sa production à partir d’énergies renouvelables pour lisser l’intermittence de ces dernières,
- son usage dans des systèmes de piles à combustible ou des moteurs thermiques offre une gamme de solutions pour décarboner les motorisations, qu’elles soient stationnaires ou mobiles,
- enfin la production en masse d’hydrogène vert (par électrolyse notamment) apporte une réponse à la décarbonation de process industriels utilisant massivement aujourd’hui de l’hydrogène produit à partir d’hydrocarbures.
Le plan France Relance adopté à l’été 2020 par le Gouvernement comporte une mesure ambitieuse pour développer une filière d’Hydrogène vert en France : un plan d’investissements de 7, 2 Md€ d’ici 2030, dont une première phase de 3,4 Md€ d’ici 2023.
L’une des missions importantes des CCI est d’accompagner et d’accélérer le développement de filières économiques et industrielles à fort potentiel de création d’emplois. Via une convention 2020-2022 entre l’ADEME et CCI France, l’ADEME a subventionné l’animation nationale du réseau des CCI sur différentes thématiques de la transition écologique par les référents et référentes nationaux au sein du réseau. L’hydrogène fait partie des thématiques visées. Les travaux du groupe national Hydrogène mis en place par CCI France en fin 2020 ont montré que dans toutes les régions des initiatives se concrétisent autour de projets contribuant à la construction de cette filière hydrogène.
De la production aux multiples usages, en passant par le stockage et la distribution sous forme de gaz comprimé ou de liquide, l’économie de l’hydrogène qui émerge présente une chaîne de valeur extrêmement dense et diversifiée. Celle-ci va nécessiter des composants, des systèmes, des expertises, des services très variés pouvant offrir des opportunités d’activités à de très nombreuses entreprises de toutes tailles.
En fonction de leurs savoir-faire propres, de leur tissu industriel et de services, tous les territoires peuvent trouver dans cette chaîne de valeur des espaces de positionnement spécifiques pour entrer dans cette économie de l’hydrogène.
Le CODIR de CCI France du 13 juillet 2021 a décidé de la contribution du réseau CCI à ces enjeux, par la reconnaissance d’un plan hydrogène des CCI et la mobilisation de ressources affectées sur l’enveloppe Relance TCCI 2021. Il s’agit pour les CCI de mobiliser les acteurs économiques (entreprises, enseignement supérieur et recherche, collectivités) afin de faire émerger des projets hydrogène porteurs de développement économique sur le plus grand nombre de territoires.
La présente synthèse regroupe les observations principales des équipes de conseillers CCI déployées sur le terrain aux côtés des porteurs de projets Hydrogène.
Méthodologie de l’opération
En 2021, les CCI de France ont déployé un programme de sensibilisation dédié à l’hydrogène sur les territoires.
Ce programme a comporté deux volets complémentaires :
- un volet sensibilisation des entreprises à l’hydrogène et à ses usages, majoritairement orienté sur les usages en mobilité.
- un volet observation et analyse des dynamiques Hydrogène propres à chaque région. Cette action a été menée par chaque CCI régionale sur la base d’une approche commune définie nationalement. Elle a consisté en une compilation des écosystèmes hydrogène existants ou en devenir, des projets de développement de briques technologiques, ainsi qu’une identification d’acteurs industriels et académiques engagés dans la construction de la dynamique hydrogène sur la région concernée.
La synthèse qui suit résulte de la consolidation des cartographies régionales. Elle offre ainsi une vue à date de la dynamique Hydrogène dans les territoires français, quelques six années après le lancement par l’État du premier appel à projet « Territoires Hydrogène », qui avait donné le top départ des mobilisations territoriales sur ce sujet.
Les données restituées ci-après ne sont évidemment pas exhaustives, compte tenu de l’évolution extrêmement rapide des projets dans le domaine de l’hydrogène. Elles permettent toutefois d’esquisser le paysage de l’économie hydrogène en cours de constitution dans les différents bassins d’emplois français.
1 - La mobilisation des territoires : En 2022, l’hydrogène est au cœur des politiques de développement économique régionale
Même si certaines régions avaient depuis plusieurs dizaines d’années fait émerger des équipes de recherche et des entreprises spécialisées sur ce vecteur énergétique, les activités économiques autour de l’hydrogène se sont principalement limitées à ses applications industrielles de masse (raffinerie, ammoniac, verrerie)jusqu’à un passé très récent. Il est important de considérer que jusqu’à ce jour l’écrasante majorité de l’hydrogène produit dans le monde pour ces applications industrielles est élaboré par un procédé (le vaporeformage d’hydrocarbures) très émetteur de CO2.
La prise de conscience de l’intérêt de l’hydrogène décarboné (produit notamment par le procédé d’électrolyse de l’eau) est récente. Le fort développement des énergies renouvelables (éolien, solaire) a posé la question de l’intermittence de la production d’électricité, et donc la nécessité de trouver des solutions de stockage ; l’hydrogène produit par électrolyse, qui ne génère aucune émission de CO2 est apparu comme une des réponses possibles.
Autre facteur accélérateur pour l’hydrogène : le besoin de décarboner les transports, à la fois pour anticiper le futur épuisement du pétrole et du gaz, mais également pour réduire, voire supprimer les émissions de CO2 ; dans cette famille d’applications, l’hydrogène se présente également comme une solution pour de nombreux cas d’usages.
L’économie de l’hydrogène, de la production aux usages en passant par le stockage et la distribution, mobilise un très grand nombre de domaines techniques et scientifiques. La chaine de valeur qu’elle représente est large et profonde, offrant ainsi des perspectives de marchés à un grand nombre de disciplines : mécanique, génie chimique, électronique, informatique, électrochimie, matériaux, traitement du signal, et à de nombreux secteurs spécialisés : réservoirs , électrolyseurs, piles à combustible, réacteurs de pyrogazéification, compresseurs , liquéfacteurs, capteurs, pompes …
Ainsi, à partir de ses compétences pré-existantes, des expertises de ses entreprises et de ses laboratoires, chaque région de France s’est engagée vers l’économie de l’hydrogène. Certaines d’entre elles en font même un axe majeur de leur politique de développement industriel.
Des projets et des acteurs hydrogène existent aujourd’hui dans toutes les régions métropolitaines et la quasi-totalité des réunions ultra-marines.
Sous l’impulsion des appels à projets nationaux, mais aussi par volonté politique forte des exécutifs régionaux, plusieurs régions se sont dotées de plans pluriannuels Hydrogène, généralement sur un temps long : 10 ans.
- Un macro -projet « Zero Emission Valley » (ZEV) en déploiement depuis 2018
- Un plan de 100 M€ sur 10 ans en Bourgogne Franche Comté, voté en 2019
- Une feuille de route H2 vert en Bretagne dans la Breizh Cop
- Une feuille de route sur 10 ans en Centre Val de Loire votée en 2021
- Un plan stratégique sur 10 ans en Grand Est voté en 2020
- Un plan régional inscrit dans Rev 3 en Hauts de France, voté en 2019
- Une feuille de route Hydrogène à 10 ans en Nouvelle-Aquitaine, votée en 2020
- Un plan hydrogène de 15 M€ sur 3 ans en Normandie, voté dès 2018
- Un plan hydrogène vert de 150 M€ sur 10 ans en Occitanie, voté en 2019
- Une stratégie IDF Territoire Hydrogène en Ile de France, délibérée en 2019
- Une feuille de route H2 vert dotée de 100 M€ en 10 ans en Pays de la Loire, votée en 2021
- Un plan régional Hydrogène en PACA, voté en 2020
Au-delà des 9 milliards d’euros mobilisés par l’État français, et des enveloppes annoncées par l’Union européenne, certaines régions annoncent des budgets dédiés dans la présentation de ces feuilles de route ou plans régionaux hydrogène. C’est le cas de Bourgogne Franche Comté (100 M€ sur 10 ans), Normandie (15 M€ sur 3 ans), Occitanie (150 M€ sur 10 ans), Pays de la Loire (100M€ sur 10 ans).
2 - Un amorçage de l’économie Hydrogène orienté par la structure des financements
L’hydrogène dans l’industrie a déjà une longue histoire de plus d’un siècle, grâce à certaines de ses propriétés chimiques.
Son utilisation en tant que vecteur énergétique pertinent (réponse à l’intermittence des énergies renouvelables, décarbonation de mobilités et de process…) est plus récente. Certaines régions (AuRA notamment par les travaux du CEA) ont fait émerger des pionniers de l’électrolyse de l’eau et de la pile à combustible.
La prise de conscience généralisée de la pertinence de l’hydrogène vert est très récente et remonte à moins de 10 ans. Elle a nécessité des phases de démonstration de la faisabilité technique des solutions, appliquées notamment à toutes les formes de mobilité.
L’accélération des 4 – 5 dernières années s’est faite sur un territoire national assez vierge d’infrastructures d’approvisionnement, en motivant des utilisateurs pionniers, souvent publics (collectivités locales) autour de solutions techniques innovantes en cours de validation technique.
Le format « Appel à projets écosystèmes » a permis de créer des conditions économiques « raisonnables » en dimensionnant les capacités de production locale d’hydrogène vert à un premier volume d’usages de proximité, sans nécessiter le déploiement d’infrastructures de ravitaillement réparties.
Sour l’impulsion de ce modèle, on retrouve assez naturellement des projets de format similaire dans les différentes régions. 80 écosystèmes hydrogène ont été ainsi recensés au travers de cette étude des CCI. A mi 2022, seule une minorité de ces écosystèmes est en fonctionnement, mais les mises en service s’accélèrent depuis le début de cette année.
A la réserve près de la comptabilité entre systèmes d’approvisionnement et véhicules, ces écosystèmes constituent un premier réseau permettant d’envisager des trajets nationaux…dans des volumes pour l’instant très limités.
En complément, l’un des principaux bénéfices de ces écosystèmes est de montrer les solutions hydrogène et leur capacité à apporter des services avec une réduction forte de l’empreinte carbone. En ce sens, l’existence de projets dans tous les territoires est un facteur favorable à la sensibilisation des acteurs économiques et du grand public.
Sur le plan des usages, les écosystèmes identifiés par les CCI concernent principalement des flottes captives de collectivités locales : bus, véhicules utilitaires, bennes à ordures ménagères. La faible disponibilité des véhicules, leur coût d’achat très élevé, et les incertitudes sur les infrastructures de maintenance sont les principaux freins évoqués par les entreprises dans l’appropriation de l’hydrogène en mobilité.
Le déploiement de quelques flottes de chariots élévateurs dans des entrepôts logistiques est le premier usage d’entreprises dont le modèle économique est compétitif dans certaines conditions d’exploitation. Des réalisations existent en Hauts de France, en Centre Val de Loire, en Auvergne Rhône Alpes et en Pays de la Loire.
Un premier déploiement quantitatif est à l’œuvre en Ile de France, avec l’usage taxi hydrogène porté par Hysetco.
Le projet Zéro Emission Valley (ZEV) de déploiement de 15 électrolyseurs, 20 stations de recharge et 1200 véhicules en Auvergne Rhône Alpes donnera une première représentation de la diffusion de l’hydrogene en mobilité à l’échelle d’une région.
3 - Un passage progressif vers des étapes plus structurantes, avec des investissements conséquents et des usages plus massifs qui esquissent des spécialisations régionales
En parallèle de ces écosystèmes, des éléments de différenciation apparaissent progressivement entre les territoires sous l’influence de plusieurs familles de facteurs liés :
- à la géographie ou à la topographie des territoires
- au tissu économique et aux expertises territoriales
- aux investissements projetés par des offreurs de solution
- aux investissements des utilisateurs publics et privés
- aux priorités stratégiques des instances politiques régionales
Bien entendu, la filière étant encore en phase émergente, ces amorces de spécificités régionales ne figent pas le paysage français de l’hydrogène de façon définitive. Notamment parce que plusieurs de ces spécialisations affichées s’appuient sur des projets dont l’issue reste incertaine.
Toutefois, la concrétisation de certains investissements significatifs (gigafactory de composants, centre d’expertise, unités de production, écosystèmes spécifiques…) dessine une première image de la France Hydrogène.(*). Sont ainsi décrits succinctement ci-dessous les principales localisations des éléments principaux de la chaine de valeur hydrogène :
La production en masse d’Hydrogène par électrolyse en lien avec des applications industrielles
5 régions portent des projets d’usines de production d’hydrogène en masse par électrolyse, pour des usages industriels d’envergure :
- En Auvergne Rhône Alpes, avec le projet Hynovy qui prévoit une production d’hydrogène pour décarboner la cimenterie Vicat et produire du méthanol
- En Hauts de France, avec un usage de l’hydrogène pour décarboner la production de l’acier (projet de réduction directe chez Arcelor Dunkerque) et pour produire des carburants de synthèse en couplant la capture de CO2 à l’hydrogène produit par électrolyse (projets C2Fuel et Reuze)
- En Grand Est, avec le projet Borealis d’usage de l’hydrogène pour la production d’ammoniac.
- En Normandie, sur le site de Port Jérome, en lien avec les activités industrialo-portuaires, dont la raffinerie Totalenergies, en intégrant également la capture du CO2.
- En Provence Alpes Côte d’Azur, sur le site de la centrale thermique de Gardanne, pour produire du méthane de synthèse et des e-carburants. Une seconde unité de production en masse est en projet sur le site de la bioraffinerie TotalEnergies de la Mède (MassHylia)
Les gigafactories d’électrolyseurs
4 régions accueillent des unités industrielles d’envergure pour produire les électrolyseurs de production d’hydrogène :
- En Grand Est, avec l’usine John Cockerill d’une capacité production de 1GW /an
- En Bourgogne Franche Comté, avec l’usine McPhy d’une capacité production de 1GW /an à Belfort, mais aussi l’usine Gen Hy près de Montbeliard, qui intègrera la fabrication de membranes d’électrolyseurs.
- En Occitanie, avec l’usine Genvia à Béziers, avec la technologie oxydes solides
- En Centre Val de Loire, avec l’usine Elogen à Vendôme, avec un objectif de 1GM /an.
Le couplage éolien offshore – production H2
Ce nouvel axe prend de l’ampleur depuis la mi 2020, en particulier dans la mer du Nord où le déploiement de parcs éoliens off-shore est le plus avancé. Il permet d’envisager à l’horizon des unités d’électrolyse de très grande capacité, offrant ainsi des perspectives de baisse de coût de l’hydrogène produit. Un petit nombre de régions françaises déjà actives sur l’éolien offshore se positionne sur ce créneau.
- En Guadeloupe, avec le projet GEO, qui envisage de produire de l’hydrogène puis de l’ammoniac, à partir d’un parc éolien offshore flottant.
- En Occitanie, avec le projet de production d’hydrogène porté par Hyd’Occ à Port la Nouvelle, dont l’alimentation électrique en phase 2 est prévue à partie du parc éolien offshore Eolmed.
- En Pays de la Loire, avec l’usine pilote de LHYFE (société créée en 2017 précisément pour produire de l’hydrogène vert à partir d’eau de mer) en Vendée alimentée en eau de mer, avec le projet pilote Sea Lhyfe au large du Croisic pour tester la production d’hydrogène en mer à partir d’énergie fournie par une éolienne flottante, avec le projet SeeOs de décarbonation par PAC des sous-stations électriques des parcs eoliens ofshore.
La production d’hydrogène à partir de biomasse
Cette technique de production est moins avancée dans son développement que l’électrolyse ; elle en est au stade de démonstrateurs échelle 1 en cours de validation et d’optimisation. Elle ouvre une voie complémentaire intéressante, avec son approche d’économie circulaire.
- En Grand Est, avec le projet R-Hynoca de pyrogazéification de biomasse, dans l’agglomération de Strasbourg
- En Bourgogne France Comté, avec le projet Avenir Energies Vertes de thermolyse de biomasse
- En Bretagne, avec le projet de conversion d’urine de porc par pyrogazéification
- En Centre Val de Loire, avec le projet de pyrolyse ImagH2In
- En Normandie, avec le projet TH2 de pyrogazéification de copeaux de bois
- En Occitanie, avec le projet Vabhyogaz
- En Pays de la Loire, avec les projets Qairos de pyrogazéification de chanvre, Hymoov de pyrogazéification de déchets de bois de classe B, ou Athena de transformation biologique d’effluents agro-alimentaires
Le stockage d’hydrogène en réservoirs
La faible densité du gaz, la petite taille de la molécule, et la très basse température de liquéfaction de l’hydrogène sont des particularités qui confèrent à la fonction stockage des exigences de technicité extrême. Que le stockage s’effectue sous forme gazeuse à plusieurs centaines de bars ou sous forme liquide à – 253 °C, les solutions à mettre en œuvre font appel à des savoir faire pointus.
- En Centre Val de Loire, avec la production de réservoirs d’hydrogène comprimé (Ullit et Raigi), et aussi des centres de recherche spécialisés dans le stockage d’hydrogène comprimé à Tours
- En Bourgogne Franche Comté, avec le centre d’expertise mondial de Faurecia sur le stockage d’hydrogène, et l’ISTHY, institut national de stockage hydrogène
- En Normandie avec la production d’hydrogène liquide (projets H2YLimobil et Hysar2)
- En Pays de la Loire, avec les unités de stockage mobile MC500 développées par Europe Technologies, mais aussi le centre de développement des réservoirs à hydrogène liquide pour les avions ( projet ZEDC)
Le stockage souterrain d’hydrogène
Pour le stockage en masse, sur les périodes longues, les réserves souterraines offrent des voies de solutions pertinentes
- En Auvergne Rhône-Alpes, avec le projet Hypster porté par Storengy sur le site d’Etrez
- En Grand Est, avec le projet de stockage en cavité saline Stor’Hy porté par Storengy, à Cerville près de Nancy.
- En Provence Alpes Côte d’Azur, avec le projet Hygreen de stockage en cavité saline dans les Alpes de Haute Provence
Le déploiement de réseaux d’hydrogénoducs
- En Hauts de France, à partir de l’hydrogenoduc Air Liquide existant ( réseau Nord H2)
- En Grand Est, avec la conversion de 2 canalisations de gaz existantes, connectées à l’Allemagne et au Luxembourg (projet MosaHyc)
La production de stations de ravitaillement en Hydrogène
- En Auvergne Rhone-Alpes, avec la société iséroise Hydrogen Refueling Stations (HRS)
La fabrication de piles à combustible
- En Auvergne Rhône -Alpes, avec la gigafactory Symbio à Saint -Fons, avec une capacité visée de 200 000 unités par an.
- En Nouvelle Aquitaine, avec l’usine HDF à Blanquefort, avec une capacité annuelle cible de 50 MW dans une première phase.
- En Ile de France, avec l’usine Renault Hyvia de Flins
La production de véhicules Hydrogène
- En Bourgogne Franche Comté, avec la fabrication d’engins logistiques Gaussin, mais aussi la production de moteurs et de véhicules de course dans la Nièvre (Ligier)
- En Grand Est, avec l’assemblage de Renault Master H2 près de Metz
- En Occitanie, avec la production de bus Hydrogene par Safra, la production de groupes frigorifiques pour remorques par Bosch , ou d’avions H2 par Mauboussin
- En Ile de France, avec l’usine Hyvia associant Renault, Plug Power et PVI pour fabriquer des Master H2, mais aussi pour le rétrofit de véhicules thermiques.
- En Pays de la Loire, avec le projet ZEH2 de Manitou pour des engins de manutention, mais aussi les rétrofit de camions portés par E-neo
- En Provence Alpes Cote d’Azur , avec le projet CatHyopé de camion à fort tonnage, hydride batterie /pac
Les usages maritimes et portuaires
- En Bretagne, avec des rétrofits de bateaux pour les mytiliculteurs dans la baie de St-Brieuc, mais aussi la construction d’un bateau passagers de 200 pax pour le golfe du Morbihan.
- En Corse, avec le projet de décarbonation des activités portuaires, porté par Corsica Energia
- En Guadeloupe, avec le projet de production d’hydrogène en mer à partie de l’énergie produite par un bateau éolien/ hydrolien développé par Farwind.
- En Normandie et Ile de France, avec l’AMI lancé en février 2022 pour faire émerger des innovations hydrogène adaptées au domaine fluvial et maritime sur l’axe Seine, et aussi avec le projet NEAC De navette fluviale autonome
- En Nouvelle Aquitaine, avec le projet Ocean Labs de PAC marinisées
- En Occitanie, avec le projet Green Harbour de barge Hydrogène au port de Sète Frontignan, mais aussi le développement d’une drague hybride ( projet Hydromer)
- En Pays de la Loire, avec navette à passagers Navibus , les projets rétrofit de navires portés par H2 Loire Vallée, le développement du bateau éolien-hydrolien Farwind de production d’hydrogène en mer
- En Provence Alpes Côte d’azur, avec le projet Hynomed de navette portuaire hydrogene , et la production du bateau Hynova
Les usages aériens et aéroportuaires
- En Ile de France, avec l’AMI H2 Hub Airport (Roissy et Orly), qui a sélectionné onze projets pour développer des solutions d’usages dans la logistique aéroportuaire au sol, et dans la propulsion des avions
- En Occitanie, avec le projet Hyport déployé sur les aéroports de Toulouse et de Tarbes
- En Pays de la Loire, avec le centre de recherche Airbus à Nantes sur le développement de réservoirs hydrogène liquide pour les avions
Les usages ferroviaires
- En Bourgogne Franche Comté, avec la production de trains H2 par Alstom,et la coommande de 3 TER
- En Auvergne Rhone-Alpes, avec la commande de 3 TER
- En Grand Est, avec le projet de 3TER sur la ligne Thann Mulhouse
- En Occitanie, avec le démonstrateur Régiolis et le développement de la chaine de traction d’une train à Tarbes par Alstom
La production de groupes électrogènes hydrogène
- En Bourgogne Franche Comté, avec l’unité de fabrication de H2sys à Belfort
- En Centre Val de Loire, avec la fabrication des unités Powidian
- En Ile de France, avec la ligne de production Eodev GenH2 sur le site de Eneria à Montlhéry
L’injection d’hydrogène dans le réseau gaz
- En Hauts de France, avec le projet GRHYD qui a permis de tester les injections de différents pourcentages d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel.
- En Centre Val de Loire, avec le projet MarHy qui prévoit une unité de méthanation puis d’injection dans le réseau.
- En Provence Alpes Côte d’Azur, avec le projet Jupiter 1000, premier démonstrateur industriel de Power-to-Gas combiné à la méthanation pour le stockage d’électricité renouvelable sous forme d’hydrogène ou de méthane dans le réseau gazier.
4 - L’émergence d’un tissu industriel français de fournisseurs spécialisés dans les composants de la chaine de valeur de l’hydrogène
Dans le sillage des projets structurants cités précédemment, une industrie des composants spécialisés de la chaine de valeur hydrogène commence à émerger avec des PME et ETI qui se diversifient sur ce marché.
Comme le montre la liste ci-dessous, les besoins en savoir -faire de robinetterie, chaudronnerie, tuyauterie, électronique, composites sont nombreux. Les exigences particulières de mise en œuvre de l’hydrogène (pressions élevées, cryogénie, étanchéité…) exigent des expertises très pointues dans la conception et la fabrication de ces composants souvent peu visibles mais essentiels. Les savoir-faire acquis par les PME françaises dans le nucléaire, l’aéronautique, l’oil and gaz, la santé, l’automobile sont tout à fait valorisables et pertinents dans l’univers de l’hydrogène. Certaines de ces entreprises ont déjà une notoriété internationale ; la visibilité au -delà des frontières est un enjeu pour toutes ces fournisseurs de composants stratégiques.
Quelques exemples pour illustrer cette diversité de spécialités :
- SRT microcéramique (41) qui produit des composants en céramique pour les PAC haute température,
- Borgwarner (41) qui produit des injecteurs pour des moteurs à combustion H2
- Plastivaloire (37) qui produit des plaques bipolaires
- Schrader (25) qui produit des dispositifs de sécurité pour les systèmes de stockage haute pression
- Sundine (21) qui produit des compresseurs à membrane
- Suntech Industries (21) qui produit des vannes spéciales hydrogène
- AKG (57) qui produit des échangeurs de chaleur
- EFFBE (68) qui produit des membranes spéciales
- Fives Cryo (88) qui produit des pompes cryogéniques
- Loiretech (44) qui produit des réservoirs composites sous pression
- Tronico (85) qui produit des convertisseurs DCDC
- Fetis Group (44) qui produit des chaines cinématiques intégrant des PAC pour les engins offroad
- Cryostar (12) qui produit des équipements cryogéniques
- Fact (31) qui produit des vannes de régulation
- Hycco (31) qui produit des plaques bipolaires
- Bernard Controls (95) qui produit des actionneurs de vannes
- FillInDrive (75) qui édite une suite de solutions cloud pour la gestion des stations H2
- Filtres équipements qui produit des réservoirs sous pression
- Giraudin Sauer (95) qui produit des compresseurs à piston
- Meca inox (95) qui produit des vannes à tournant sphérique
- …
5 - Un ensemble organisé de chercheurs et de laboratoires spécialisés assez largement répartis dans les différentes régions
Plus de 300 chercheurs issus de 29 laboratoires sont regroupés au sein de la fédération de recherche du CNRS. Les travaux conduits par ces équipes sont concentrés sur la production d’hydrogène par électrolyse, le stockage, et les piles à combustibles. Ces différents laboratoires sont assez bien répartis sur le territoire national. Leurs activités sont décrites dans le site de la FRH2
- Auvergne Rhône Alpes : 3 (Grenoble, Saint-Etienne)
- Bretagne : 1 (Rennes)
- Bourgogne Franche Comté : 2 (Belfort)
- Centre Val de Loire : 1 (Orléans)
- Corse : 1 (Ajaccio)
- Grand Est : 3 (Nancy, Strasbourg)
- Occitanie : 4 (Toulouse, Montpellier)
- La Réunion : 1 (Saint-Denis)
- Hauts de France : 2 (Lille, Amiens)
- Ile de France : 4 (Paris, Thiais, Orsay)
- Nouvelle Aquitaine : 4 (Poitiers, Bordeaux, Limoges)
- Pays de la Loire : 3 (Nantes, Saint-Nazaire)
En complément, la filière hydrogène française peut aussi compter sur les expertises de plusieurs plateformes de recherche innovation qui permettent de couvrir d’autres champs technologiques comme la production à partir de biomasse, la combustion d’hydrogène ou la marinisation des équipements.
C’est ainsi que :
- la région Bourgogne Franche Comté compte 3 plateformes de RD, test et qualification sur les piles à combustible (Hyban) et sur le stockage ( IstHy et le Core H2 Center de Faurecia).
- AuRA abrite le Centre de recherche du CEA sur la pile à combustible PEMFC, et sur l’électrolyse de l’eau à haute température
- En Centre Val de Loire se trouvent à Tours le centre de recherche du CEA sur le stockage d’hydrogène gazeux, et à Orléans un pôle sur la combustion d’hydrogène et les risques associés.
- En lle de France, le Centre thermodynamique des procédés (CTP) de Mine Paris Tech conduit des travaux sur les conditions de liquéfaction de l’hydrogène.
- En Normandie, CORIA et l’INSA de Rouen travaillent sur la production d’hydrogène à partir de biomasse, la combustion de mélanges H2
- En Nouvelle Aquitaine, l’Université de Pau mène des travaux sur la génération d’hydrogène naturel, et l’institut de recherche sur les céramiques ( IRCER) à Limoges étudie des systèmes catalytiques
- La région Occitanie a lancé un projet de Technocampus H2 à Francazal ,orienté applications aéronautiques de l’hydrogène. A Albi l’école des Mines mène des travaux sur la pyrogazéification , mais aussi sur les matériaux pour le stockage gazeux comprimé.
- En Pays de la Loire, l’école Centrale opère à la fois sur les moteurs à combustion d’hydrogène, mais aussi sur le couplage énergies marines Hydrogène sur son site d’essais en mer SEMREV. Le GEPEA à Saint -Nazaire travaille sur l’optimisation énergétique des procédés Power to Gaz. L’IRT Jules Verne a lancé des travaux sur le stockage d’hydrogène liquide dans les avions. Le CEATECH de Bouguenais s’est doté d’une plateforme de marinisation des composants de la chaine de valeur hydrogène. Enfin le CETIM a décidé d’implanter à Nantes une plateforme Hymeet dédiée au stockage d’hydrogène sur les matériaux, l’étanchéité et la sécurité.
6 - Des formations spécialisées H2 encore peu nombreuses, et majoritairement centrées sur le niveau ingénieur.
France Hydrogène a produit un référentiel des besoins métiers et compétences de la filière H2 qui répertorie 84 métiers, dont environ 1/3 nécessitent des profils experts dans le domaine de l’hydrogène.
A ce jour, l’offre spécialisée reste très peu dense. Elle est majoritairement appuyée sur des écoles d’ingénieurs et des universités, avec des approches par modules. Quelques expériences d’usage mixte de démonstrateur H2 couplé à de la pédagogie apparaissent.
Plusieurs de ces initiatives reposent sur une implication d’industriels spécialisés H2
En termes de positionnement, ces modules vont du généraliste transversal H2 à des spécialisations : stockage / électrolyseurs / PAC.
Enfin, le public adressé est le plus souvent de niveau ingénieur ; il existe encore peu de formations opérateurs / techniciens.
Comme pour les activités industrielles et de recherche, les enseignements Hydrogène sont répartis sur la plupart des régions de la métropole :
- En Auvergne Rhône-Alpes, 25 écoles d’ingénieurs ont intégré des modules concernant l’hydrogène dans leurs cursus. Parallèlement, en 2020 a été créée la Symbio Hydrogen Academy, dont l’objectif est de former 300 personnes par an .
- En Bretagne, l’université de Bretagne Sud développe un diplôme d’ingénieurs « énergie et H2 »
- En Bourgogne France Comté, le CMI « Hydrogène énergie et efficacité énergétique » de l’Université de France Comté forme des ingénieurs, ainsi que le Mastère spécialisé Hydrogène énergie de l’UTBM. Par ailleurs, la région BFC a déployé 5 stations H2 dans des lycées, à des fins pédagogiques.
- En Grand Est, un projet de centre international de qualification et de certification de composants H2 porté par l’Institut de soudure à St-Avold et l’IUT de Moselle Est. L’Université de Lorraine déploie en M1 et M2, 2 modules sur le stockage électrochimique (30h) et les technologies de l’hydrogène (20h)
- En Hauts de France, l’IUT Côte d’Opale à Dunkerque propose un « banc pédagogique » consacré à la production et au stockage de l'hydrogène dans le cadre d'un module de BUT « Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques ».
- En Ile de France, un Mooc Momentom est proposé par l’université Paris Saclay, en complément des modules intégrés au master Energie, et e la licence L3 professionnelle sur les « techniques physiques des énergies bas carbone ». L’ENSAM Paris propose une formation intégrant des modules sur le stockage de l’hydrogène et certains composants de la pile à combustible. De même, Mines Paristech propose un enseignement spécialisé filière H2
- En Normandie, Caux Seine Agglo porte le projet de création de H2 Academie. Depuis septembre 2021, le lycée de Bolbecq a ouvert un BTS maintenance des fluides dédié montage et entretien électrolyseurs.
- En Occitanie, un projet de Technocampus Hydrogène à Francazal, avec une visée applicative « avion vert ». L’eveerHypole d’Albi produira en 2024 une première promotion diplômante spécialisée H2 pour les niveaux Bac, BTS et licence.
- En Pays de la Loire, Centrale Nantes a ouvert un module énergies décarbonées (PAC et H2) dans l’option Production et gestion d’énergies. Polytech Nantes opère un module sur les générateurs électrochimiques.
- En Provence Alpes Côte d’Azur, HYVAR offre des formations aux métiers H2 et mobilité déployées par CAPFORMA (CCI Var) : 10 modules disponibles élaborés avec Chabas et Green GT, orientés sur les applications H2 Mobilité. Par ailleurs, l’Université Cote prépare un démonstrateur pédagogique pour les étudiants de l’école d’ingénieurs Polytech Nice (H2eliotech) avec l’assistance de Bouygues services, Powidian et Solstyce.
7 - Le réseau des CCI mobilisé pour faire entrer les entreprises dans l’économie de l’hydrogène
A quelques rares exceptions (Hauts de France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côtes d’Azur), l’engagement des CCI dans la dynamique hydrogène est assez récente et a surtout été déclenchée par l’appel à projets «Territoires Hydrogène » en 2016.
Fin 2020, dans le cadre du plan de relance, les CCI se sont organisées autour d’un groupe national Hydrogène réunissant des chefs d’entreprises, élus CCI, de chaque région, avec des collaborateurs référents hydrogène.
Pour que l’effet de cette nouvelle filière soit maximal sur l’économie nationale, il importe :
- que les offreurs de solution (petits et grands) déjà engagés intensifient les collaborations pour atteindre la vitesse de croissance exigée par cette compétition mondiale ;
- que les usagers potentiels comprennent les avantages de ces solutions, et les adoptent rapidement et en masse pour que les effets d’échelle sur les coûts jouent à plein ;
- que les entreprises disposant d’expertise et de savoir-faire pertinents pour cette filière puissent rapidement les faire valoir auprès des potentiels donneurs d’ordre en pilotant au mieux des démarches de diversification.
Au stade actuel, la situation ressemble à celle de « la poule et l’œuf » : les usages sont trop peu nombreux pour que les investissements soient rapidement déployés, tant dans la production de l’hydrogène que dans les équipements d’usage (véhicules par exemple). Réciproquement, la faible disponibilité de solutions combinée avec leur coût élevé du fait des faibles volumes (stations de ravitaillement, véhicules…) est peu incitative au développement des usages.
Aussi, les CCI ont l’ambition, au travers de ce programme d’actions national conçu de façon collaborative par des acteurs de terrain connaissant parfaitement les tissus économiques locaux, d’accélérer la compréhension des apports de l’hydrogène dans l’économie et de faciliter l’engagement dans l’action.
Les CCI ont ainsi déployé en 2021 :
- Des actions de sensibilisation auprès des entreprises potentiellement utilisatrices d’hydrogène pour expliquer les avantages de ce vecteur. Les cibles prioritaires ont été les entreprises disposant de flottes de véhicules importantes, en particulier des véhicules lourds, des engins de manutention, des flottes à rayon d’action court permettant d’envisager un approvisionnement sur un point de distribution unique. Plus de 8000 entreprises ont été sensibilisées au travers de différentes actions (réunions, webinaires, conférences, newsletters…)
- Des accompagnements de projets d’entreprises offreuses de solutions pour accélérer leur développement, par exemple en les mettant en relations avec des laboratoires, en créant des consortium pour candidater à des appels à projets, en contribuant à la construction de ces dossiers de candidature, en recherchant du foncier pour l’implantation de gigafactories (ex en CCI Ile de France).
- Des animations de type colloque ou salons, en lien avec les autres acteurs (pôles de compétitivité, agences de développement) pour créer des dynamiques territoriales Hydrogène (ex : AmbHyCCIon en Grand Est)
- Des structurations de clusters (CCI des Côtes d’Armor, CCI du Var…)
- Des systèmes de veille spécialisées hydrogène (CCI Hauts de France, CCI Normandie, CCI Pays de la Loire)
- Des enquêtes spécialisées hydrogène (CCI Nouvelle Aquitaine, CCI Pays de la Loire)
- Des dispositifs de formation (CCI du Tarn avec Alb-Hy campus, CCI du Var avec Hyvar)
- La plateforme CCI Business Hydrogène. Cet outil développé par la CCI Normandie a été déployé au niveau national pour créer une communauté d’acteurs de l’hydrogène. Son objectif est de favoriser la mise en réseau et les développements de projets, aider les PME (composants, systèmes, équipements, services) à se positionner sur les nouveaux marchés à venir, et maximiser les retombées économiques du développement de la filière hydrogène sur les territoires.
Être référencé dans la communauté CCI Business Hydrogène permet de :
- Gagner en visibilité en apparaissant sur la cartographie des compétences Hydrogène,
- Recevoir une information qualifiée sur l’actualité hydrogène et les opportunités d’affaires,
- Développer son réseau.
234 acteurs sont actuellement référencés sur la plateforme